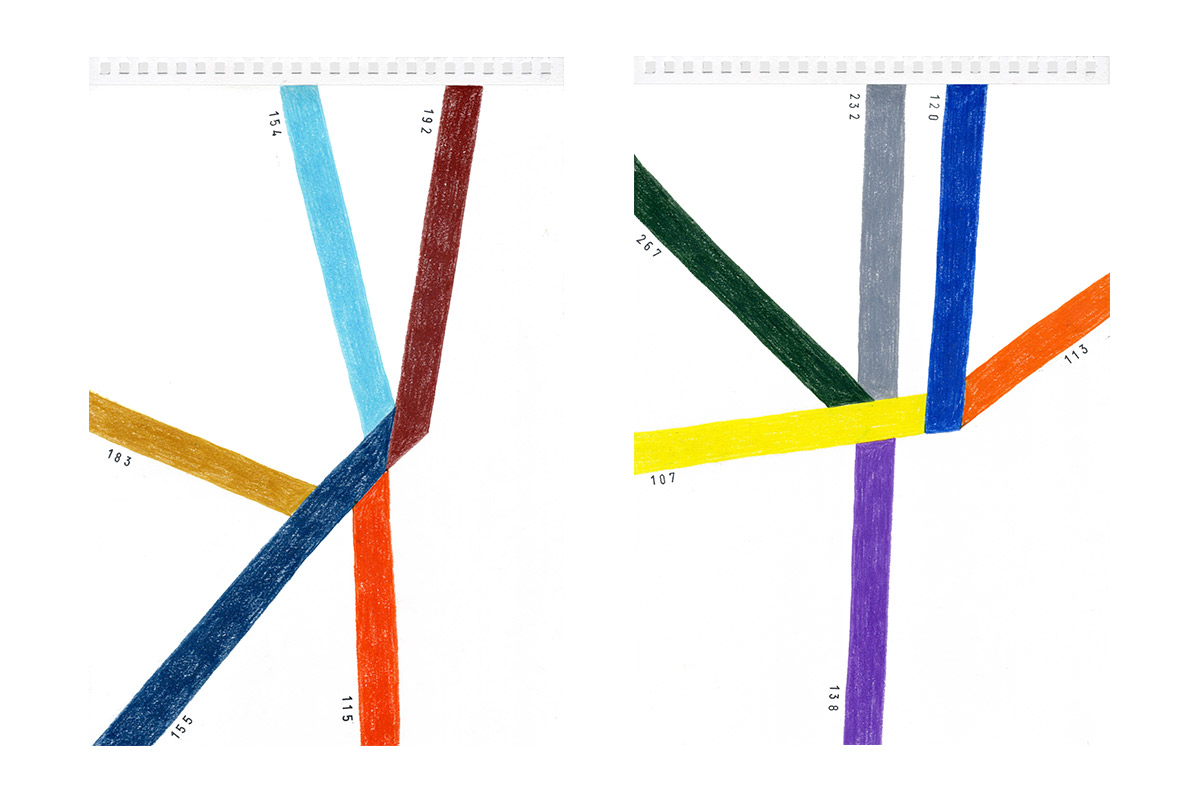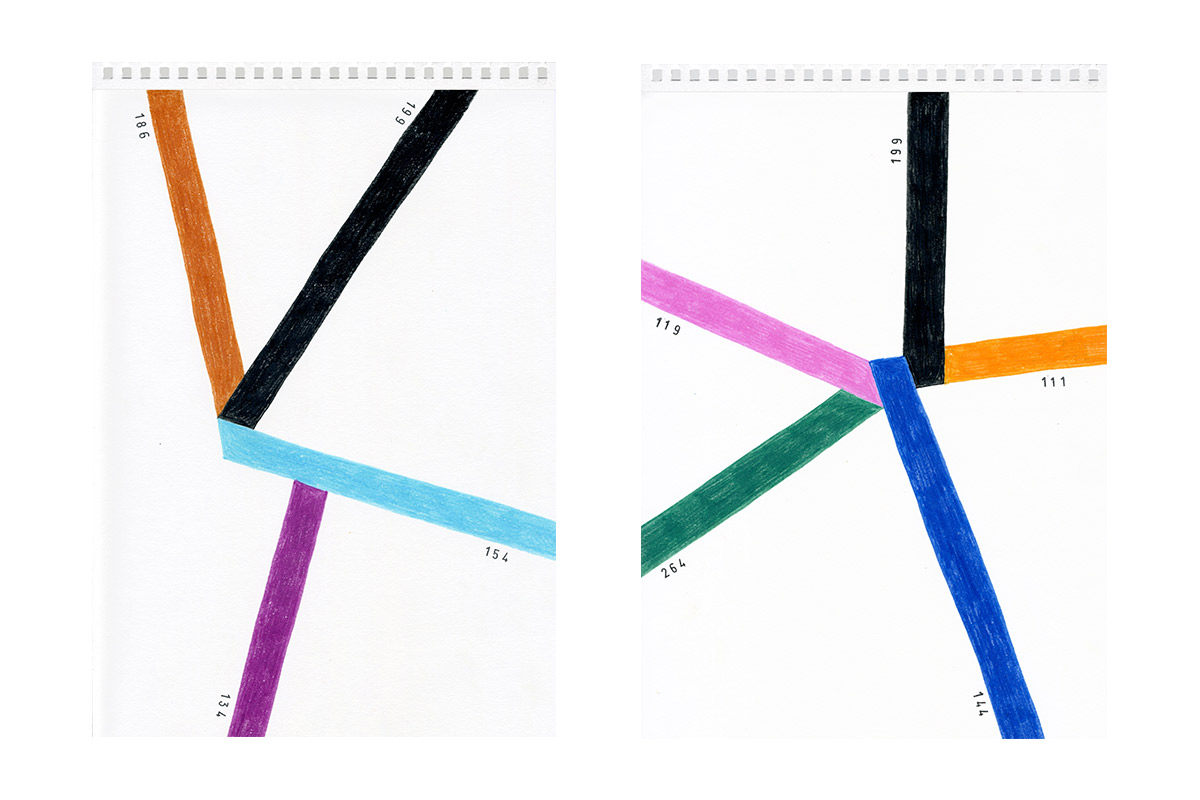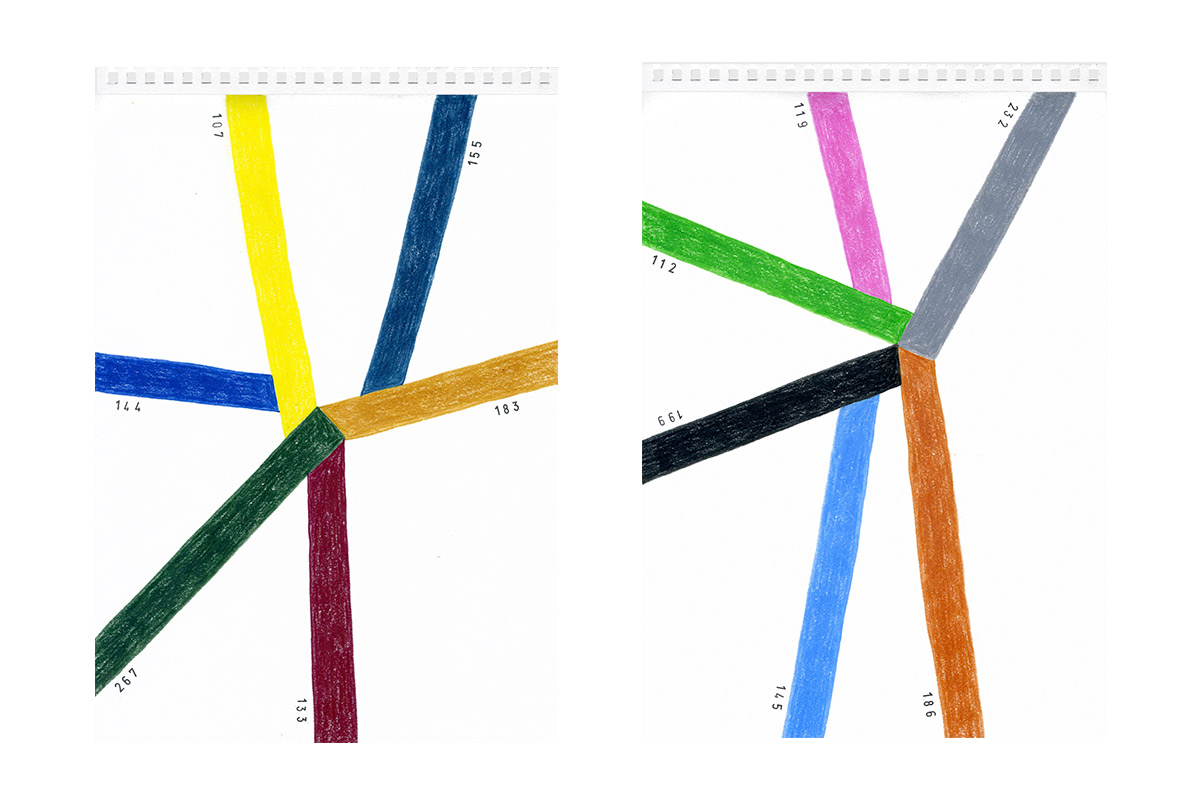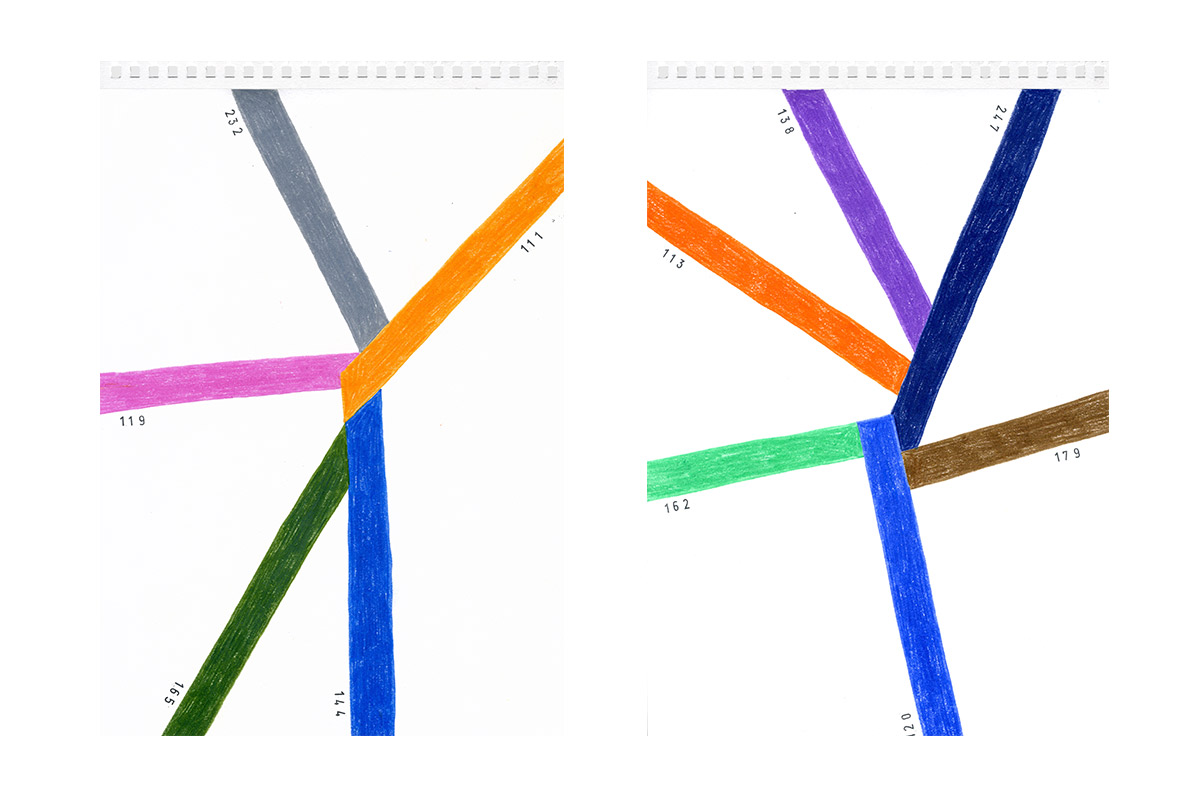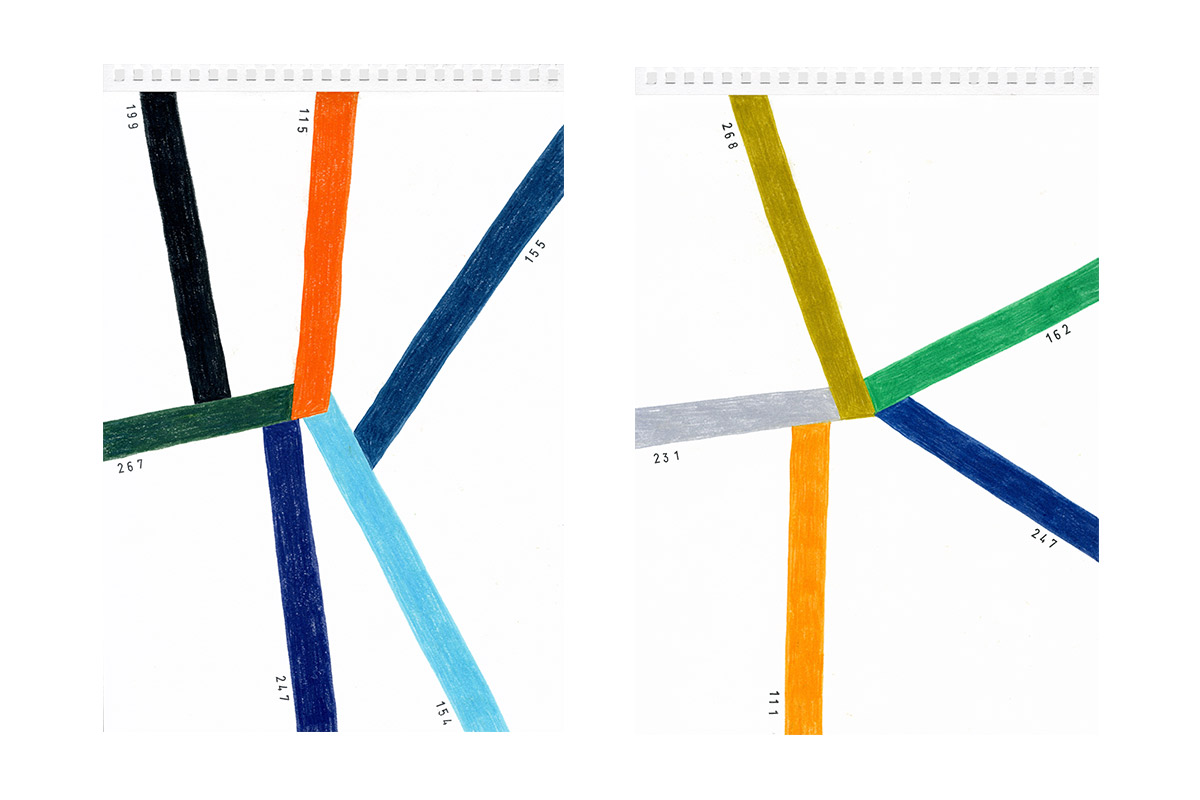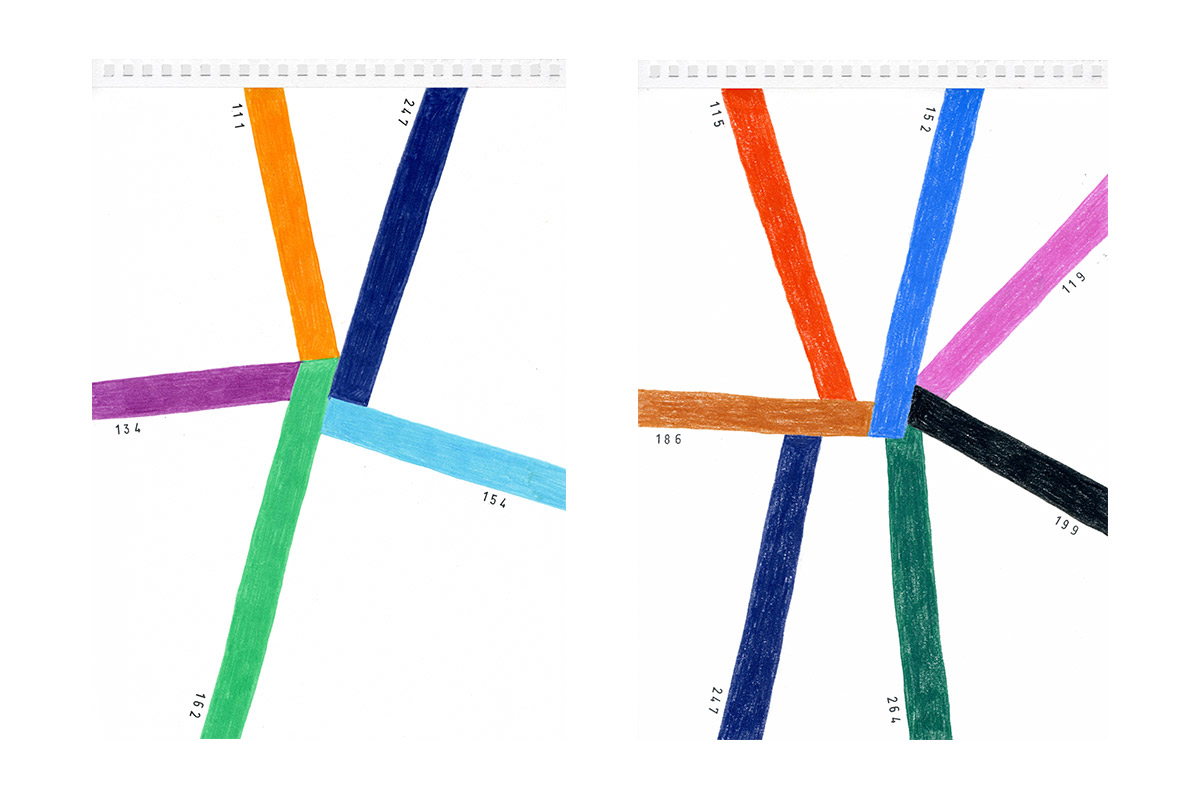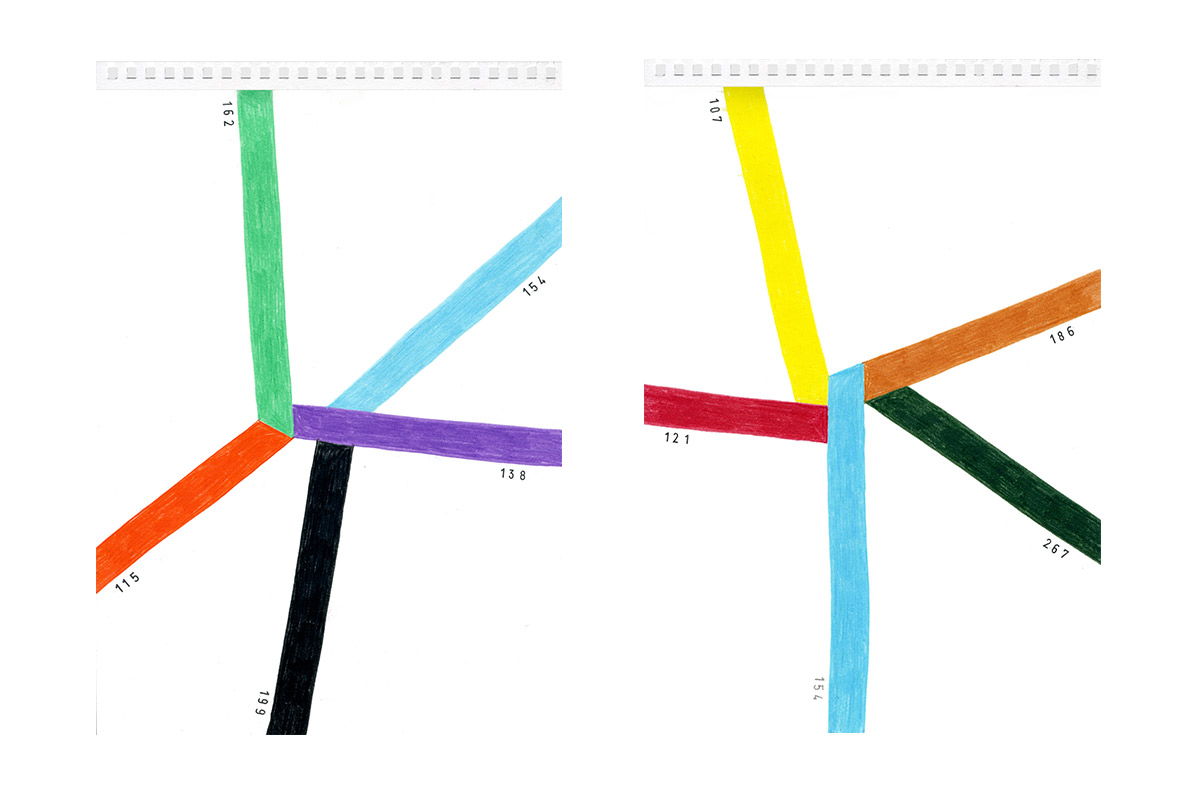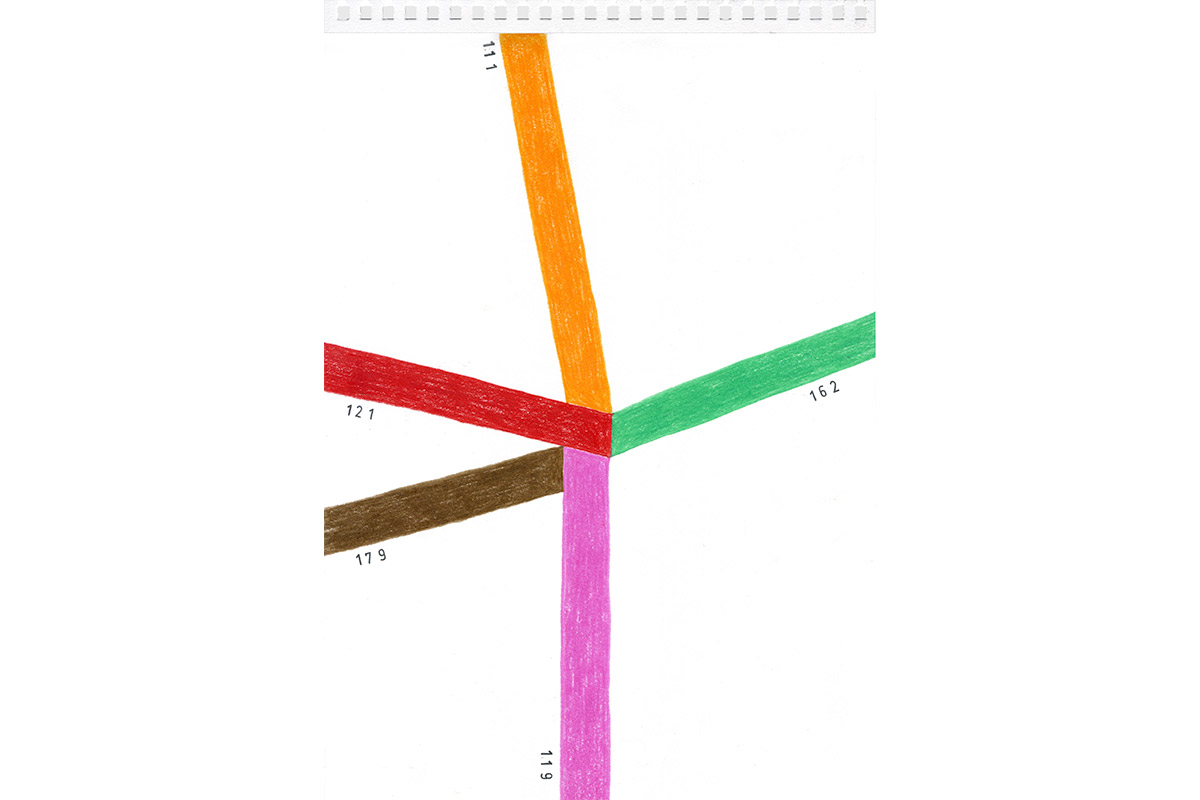Le Monde de l’IA
Depuis 2009, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis soutient « la Culture et l’Art au Collège (CAC) ». Cette démarche repose en grande partie sur la présence, en classe et pendant plusieurs semaines (40h), d’un artiste ou d’un scientifique ayant pour mission d’engager les élèves dans un processus de recherche et de création.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la démarche d’éducation aux médias AGORA.
Intervenant-e-s:
JOURNALISTES
Chargée de projet:
FLORISE PAGÈS
Atelier
Objectif :
En mars 2024, le journal « Le Monde » annonçait un accord exceptionnel avec OpenAi, concepteur de l’application ChatGPT. Le journal a accepté que des élèves puissent librement revenir sur cette opération avec l’aide d’un journaliste. La classe aura la possibilité de raconter ce que change ce partenariat, en interne et pour les lecteurs ; elle pourra aussi parler des attentes et des craintes formulées, solliciter pour cela des spécialistes de l’IA, d’autres rédactions, sans oublier de proposer un regard plus personnel de la situation.
Peurs et fantasmes
En premier lieu, les élèves approfondissent leurs connaissances de l’IA. Ils rencontrent un informaticien qui explique comment fonctionnent et s’entrainent les logiciels, où trouve-t-on l’IA dans notre quotidien… ; avec le journaliste, ils mettent au défi les élèves de discerner le vrai du faux à partir d’articles, de posts ou d’images et discutent de leurs pratiques informationnelles, des Deepfake et de la vérification des sources. Le responsable au journal Le Monde Gilles Van Kote vient alors en classe détailler les objectifs de la convention signée avec Open AI et le Monde afin de planter le contexte.
Un alter ego qui a réponse à tout
D’un côté, une classe s’interroge sur les bouleversements entrainés par l’arrivée de l’IA dans la profession de journaliste. Une fois les modalités de l’entretien définies avec le journaliste, par groupes ils ciblent les thèmes à aborder pour produire une série des questions et font leurs recherches sur chacun d’eux: quels gains et quels risques dans la production de l’info, comment en prévenir les écueils, faut-il se former, pourquoi entrainer l’IA avec leurs articles… ? Puis ils se rendent au journal Le Monde, rencontrer un journaliste et mènent leur entretien. Après une première analyse des réponses en classe, les élèves se penchent sur les autres rédactions qui ont refusé cet accord avec Open AI, tels que RadioFrance ou TF1, et invite au collège un de ses représentants pour recueillir ses arguments et échanger sur ce thème. Un temps de synthèse s’ensuit qui permet au groupe de produire ses propres remarques et soulever ses propres interrogations sur le sujet, en vue du temps de présentation de la restitution finale.
Grok vs Spinoza
En parallèle, pour la seconde classe, il s’agira de réfléchir à des questions à poser à la direction du Monde sur l’engagement du journal d’un point de vue déontologique : qu’est-ce que cela implique d’être une rédaction indépendante et de collaborer avec les géants de la Tech devenus puissances politiques, pour quelles contreparties, quelle est leur position sur les droits d’auteur, sur l’impact écologique de la puissance de calcul de l’IA, sur son coût qui risque de creuser des inégalités parmi les médias ? Si les rédactions sont responsables des contenus, sont-elles en mesure d’assurer une supervision humaine ? Après avoir fait des recherches pour creuser ces thèmes, les élèves se rendent au journal mener leur entretien. De retour en classe, ils discutent et analysent les réponses obtenues. Les élèves se penchent ensuite sur les alternatives possibles et sur les rédactions qui ont refusé cet accord avec Open AI, et invitent au collège un représentant de Reporter Sans Frontières à expliquer pourquoi ils ont développé « Spinoza », leur propre modèle de langage, plus éthique et européen. Un temps de synthèse s’ensuit qui permet au groupe de produire ses propres remarques et soulever ses propres interrogations sur le sujet, en vue du temps de présentation de la restitution finale.
Cette page accueille les dessins Sans titre, 2023, du designer Pierre Charpin.